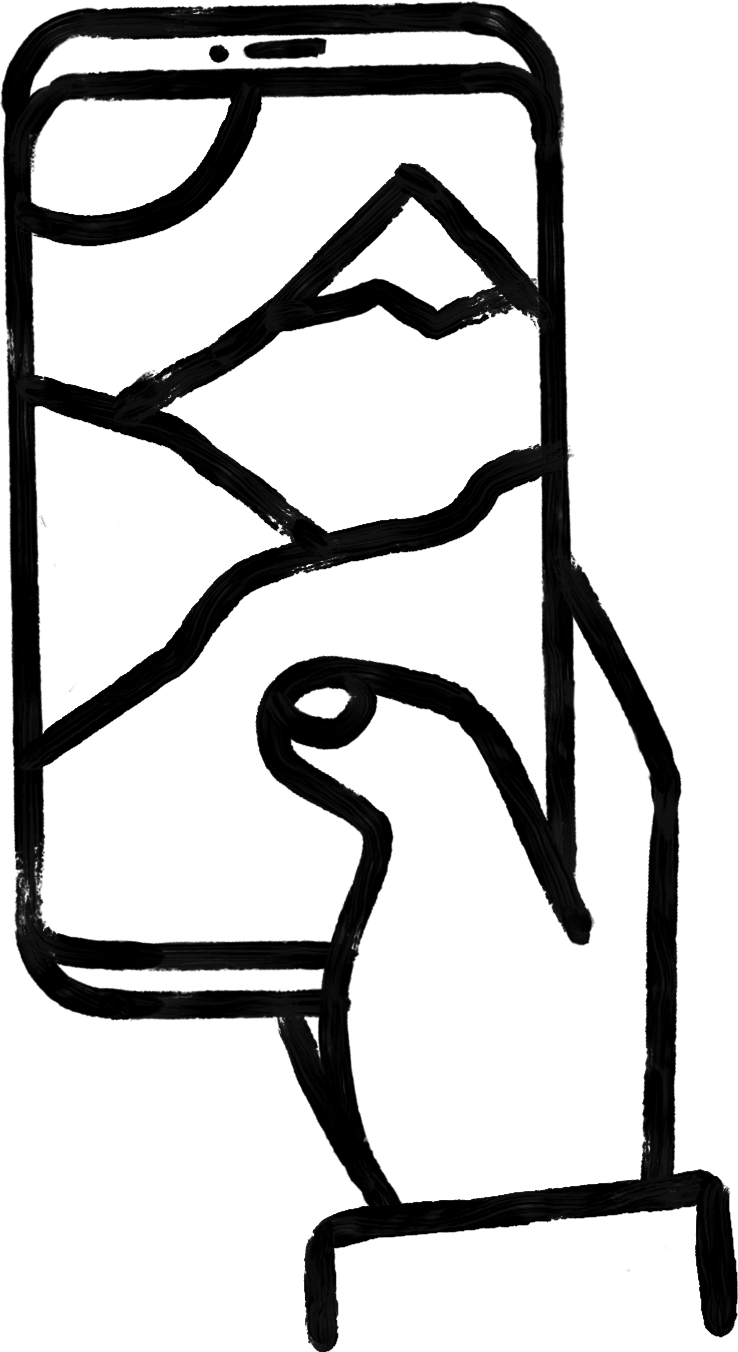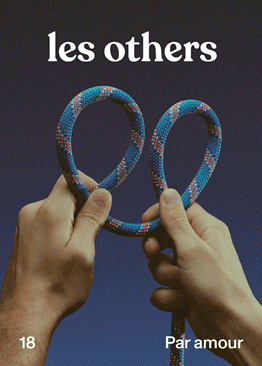Par Gaëtan Vidal
Au pays des ours : 800 kilomètres à vélo en Colombie-Britannique
Temps de lecture : 17 minutes
En septembre dernier, Gaëtan Vidal a profité de la réouverture des frontières pour partir en Colombie-Britannique. Une idée lui trottait dans la tête depuis un moment : une aventure en bikepacking de plusieurs centaines de kilomètres dans les traces des ours, un animal qui le passionne.
Il a embarqué seul, avec son vélo et ses sacoches, son téléobjectif et son vieil argentique, et l’espoir de faire de belles rencontres. Ça tombe bien, la remontée des saumons bat son plein au mois de septembre, et les ours sont aux rendez-vous dans les forêts de l’Ouest canadien…
C’est ici, dans les forêts de Colombie-Britannique peuplées de grands prédateurs tels que le loup, le cougar, le grizzly et l’ours noir, que les premiers prospecteurs se sont aventurés au XIX ème siècle. Arrivée aux oreilles de quelques cinglés, la rumeur d’une pépite d’or dans la rivière Bonanza Creek a attiré plusieurs milliers d’hommes dans les années 1890. Leur baluchon sur l’épaule, ils ont parcouru des kilomètres, construit des cabanes, pioché la terre, retourné le limon des rivières, combattu le froid glacial et l’hiver interminable pour qu’une poignée d’entre eux trouvent quelques grammes du métal précieux.
Séduit par le romantisme et la pugnacité de ces hommes prêts à tout quitter pour le Nord et l’or, un photographe de San Francisco du nom d’Arthur Clarence Pillsbury partit sur sa bicyclette pour documenter le Klondike. Son histoire m’a profondément inspiré, et c’est en grande partie grâce à ses récits que j’ai entrepris mon périple.
9 septembre
Le voyage ne pouvait pas plus mal commencer. Je viens de louper mon vol qui connecte Vancouver à Prince Rupert, bourgade de pêcheurs du Nord Ouest de la Colombie Britannique. C’est là que devait débuter mon périple. Je dois revoir mon itinéraire en urgence, pas le choix. Après tout, n’est ce pas cela l’aventure ? Côté bonne nouvelle, le carton d’emballage a tenu le coup et mon vélo arrive à destination en un seul morceau.
Une fois passé les douanes, il me faut quitter l’aéroport. C’est l’heure de pointe à Vancouver, les grands axes sont saturés, les premiers coups de pédales sont durs, je ne suis pas dans mon élément et mon vélo n’a jamais été aussi chargé. Au bout d’une heure, je quitte cette fourmilière humaine pour rejoindre le Park Stanley, un écrin de verdure niché au centre de la métropole, avant de continuer ma route vers le Nord de la ville.
Après inspection de ma carte papier, je file en direction de la Sea To Sky highway. Je compte passer la nuit à Squamish, à une soixantaine de kilomètres d’ici. Il n’y a qu’une seule route qui mène au Nord depuis Vancouver, c’est une autoroute empruntée par des camions chargés de bois et d’énormes 4×4 Pickups. Les Canadiens en sont friands. C’est tout le paradoxe de ce pays riche en espaces naturels et forêts somptueuses, où les habitants aiment pourtant conduire de grosses bagnoles qui polluent beaucoup et font énormément de bruit.
J’ai à peine la place pour mon vélo sur le bord de la route, je dois me contenter d’une bande de goudron d’à peine 50 centimètres, jonchée de gravillons. Il y a parfois si peu de place que je suis obligé de poser pied à terre pour continuer sur le bas-côté. Je reste motivé en imaginant les premiers saumons frayer…
11 septembre
Je reste quelques jours sur Squamish. La ville est sympa et j’ai rencontré un photographe originaire du Sud de la France, comme moi. On a bu quelques bières. En plus d’être talentueux, Alex est un gars vraiment sympa.
J’accuse encore le décalage horaire. Je m’endors tôt et me réveille encore plus tôt. J’ai posé ma tente à proximité d’une rivière. Il est 6h00 du matin, les premières lueurs de l’aube ne tardent pas à se manifester. Je tourne et me retourne dans mon sac de couchage, mais l’appel de l’exploration est trop fort, je me lève.
J’amène avec moi mon téléobjectif et mon bear spray, une bombe au poivre en cas d’attaque d’ours, il est conseillé de se balader avec ça ici. J’entreprends de marcher sur le sentier qui longe la rivière Mamquam. Elle n’est pas loin, si j’en crois l’odeur de poisson pourri qui monte peu à peu.
Les saumons sont bien là, par dizaines. Ce sont des Sockeye. La plupart meurent d’épuisement après leur long périple entrepris depuis l’Océan pacifique jusqu’ici. Chaque année, à la même période, ce cours d’eau voit la remontée des saumons, pour le grand bonheur des ours, coyotes et autres pygargues à tête blanche.
Cela fait à peine une quinzaine de minutes que je marche. Je pénètre en silence dans un sous-bois. Le décor est féérique, les résineux tapissés de lichens et de mousse verte émeraude. Soudain, j’entends un bruit de branches se briser juste devant moi. Un arbuste s’agite. Deux oursons en sortent et grimpent à toute vitesse en haut d’un arbre d’où il me regardent en me grognant.
Mon coeur s’emballe car je ne vois pas la mère. Ce genre de situation peut s’avérer très dangereuse. Chaque année, au Canada, des accidents ont lieu quand des personnes se retrouvent malencontreusement entre une mère et ses petits. Un oeil à gauche, rien. À droite, toujours rien. Mon regard se porte vers le ruisseau en contre-bas où j’aperçois une jolie ourse affairée à déguster un Sockeye. Le museau planté dans la chair rouge du poisson elle ne m’a pas senti. Je recule doucement en prenant garde ne faire aucun bruit. Je sors mon appareil photo, les bras tremblants je déclenche. La photo est floue, qu’importe.
À quelques mètres sur ma droite, une ouverture entre deux arbres mène sur une plage de galets. Je choisis de prendre ce chemin et de m’éloigner avant que la mère ne remarque ma présence. Les battements de mon cœur parviennent à diminuer au bout de longues minutes. Je n’ai jamais rien vécu d’une telle intensité. Une vraie décharge d’adrénaline.
Une partie de moi me pousse à retourner dans le bois pour voir ce que la petite famille d’ours y fait, mais une autre partie, plus raisonnable, m’en empêche. Je remonte la rivière par la berge et rebrousse chemin vers ma tente. On peut dire que pour ma première journée dans cette contrée, je suis bel et bien entré dans le vif du sujet.
14 septembre
Les choses sérieuses commencent. Aujourd’hui, je dois franchir le Cayoosh Pass, un col de première catégorie, long de 14 kilomètres avec un dénivelé positif de 1 053 mètres. Chez moi, en France, il m’arrive de grimper de petits cols sur la montagne noire, mais je ne suis jamais autant chargé. Ici, il n’y a pas d’échappatoire possible. Si je veux progresser dans mon itinéraire, il va falloir que je passe tous les obstacles qui se présenteront sur mon chemin.
Je décolle de Pemberton, une petite ville que je laisse avec un pincement au cœur tant j’ai apprécié d’y séjourner ces deux derniers jours. J’y ai même vu un ours dans le jardin d’un chalet alors que je rentrais de boire quelques bières dans la vallée des fermiers à 10 kilomètres de la ville…
Me voilà au pied du col. Je m’arrête et bois quelques gorgées d’eau avant de commencer l’ascension. Les premières pentes sont douces mais le vélo est lourd. J’accuse le coup. Au bout de seulement 3 kilomètres, je mets pied à terre. Il reste plus de 10 bornes à parcourir. Je pousse ma monture. Quand les pourcentages sont plus faibles je remonte sur la selle tant bien que mal.
Heureusement le soleil égaye mes souffrances et je parviens à gagner le sommet. Une fois là-haut, un repos de plusieurs minutes s’impose. Mais je dois faire vite car le temps se gâte, des nuages épais se dirigent dans ma direction. J’enfile ma veste de pluie et entame la longue descente qui me mènera à la ville de Lilooett, reconnue pour ses chercheurs de Jade. Je suis trempé. Je passerai la nuit dans un motel pour profiter d’une douche chaude et d’un espace où étendre mon linge mouillé.
Ensuite, je devrais choisir entre deux routes. Celle qui mène au Nord et l’autre qui mène au Sud. L’improvisation a payé jusqu’à présent, je réserve ma décision pour le dernier moment. On dit que la nuit porte conseil.
16 septembre
En vélo le temps défile au ralenti. L’intensité des moments se fait d’autant plus forte. Les souvenirs restent. Trop de planification ne mène à rien. Je fais le choix du Sud, pour la météo entre autre.
Au fur et à mesure de ma progression, les paysages, la végétation et le climat changent. L’été dernier a été dramatique ici, il y a eu énormément d’incendies de forêts. Des pans de montagnes entiers sont brûlés, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, ça fait froid dans le dos. La faune locale en payé le prix fort. Des ossements jonchent le sol sablonneux du bord des routes. Je devine une mâchoire de cervidé par terre. Plus loin, deux vautours font une ronde à la recherche de charognes dans le néant. Un geai de steller, curieux, vient se poser sur une branche. L’ambiance est lourde, je force sur les pédales.
Arrivé à Lytton, il ne reste rien. De grands panneaux et des bâches on été mis en place pour cacher cette horreur. Ce village a été ravagé par les flammes il y a quelques mois de ça. Les habitants ont dû tout abandonner, laissant derrière eux leurs maisons, leurs commerces, et prendre la route en vitesse pour ne pas y laisser leur propre vie. Je me fais interpelé par un garde, il me dit que je ne peux pas passer à vélo a cause de la mauvaise qualité de l’air liée aux incendies. Je tente de négocier mais il ne veut rien savoir et m’escorte gentiment vers une autre route. Je vais devoir à nouveau improviser.
Un peu plus loin sur le bord de la chaussée se trouve une glacière avec un mot dessus « free cold juice, stop and grab one ». Je m’exécute, saisis un jus de fruits frais. Quel délice, j’avais tellement soif et presque plus d’eau dans mon bidon. Ça ne pouvait pas mieux tomber, merci à la personne qui a mis ça là ! La route est encore longue. Je ne suis qu’à mi-chemin et un vent de face me ralentit considérablement.
18 septembre
Ce matin, il me faut pédaler une cinquantaine de kilomètres pour arriver à Merritt. Il me tarde de laisser ces paysages sombres derrière moi. Merritt est une ville dortoir à la jonction de trois axes routiers importants, un qui mène au Nord en direction de Kamloops, un autre vers le Sud en direction de Vancouver et un troisième vers l’Est. C’est ce dernier qui m’intéresse car il me permettra de rejoindre la ville de Kelowna.
Au petit matin, je reçois un sms de ma compagne. C’est mon anniversaire, j’avais oublié. Son message me fait un bien fou pour continuer mon aventure. Il est parfois dur d’être seul. Le soir venu, j’achète une pâtisserie et j’y plante une bougie, pour le symbole. J’ai bien analysé ma carte, je dois pouvoir couper à travers champs pour rejoindre l’axe 97. La traversée me prendra au moins deux jours par la piste. Je ne connais pas encore ce coin de la Colombie-Britannique et je suis curieux de m’y aventurer.
19 septembre
Je traverse un paysage magnifique. Quand le bitume laisse place à la piste, la magie a opère. Des landes dorées à perte de vue, un relief valloné et des petits lacs. J’observe beaucoup d’espèces d’oiseaux, dont un couple de balbuzards pêcheurs posés dans leur nid sur un poteau électrique, je n’en avais jamais vu auparavant. Il y a de la vie par ici.
Ce soir, la nuit s’annonce fraiche. Je trouve un terrain plat à une cinquantaine de mètres de la piste, près d’un lac. L’endroit est idéal pour y poser le camp. Hérons et autres oiseaux aquatiques se partagent le plan d’eau. Sur la crête de la colline qui me fait face, j’aperçois des chevaux qui avancent en file indienne, il sont au trot et se dirige dans ma direction, Je peux facilement en compter une quinzaine, la lumière descendante rend la scène superbe.
Je suis assis dans ma tente, appareil photo en mains, et je profite du décor quand soudain il me semble sentir le sol trembler. Il fait quasiment nuit, je lève la tête et parviens tant bien que mal à deviner ce qu’il se passe. Le bruit des sabots s’accentue et l’inquiétude me gagne. Les chevaux descendent au galop de la colline pour aller boire dans le lac mais j’ai planté ma tente en plein milieu de leur route !
Ce qui semble être l’étalon dominant du groupe se tient là à une dizaine de mètres, les oreilles dressées vers le ciel. J’entends son souffle nerveux, la clarté ambiante me permet de supposer qu’il me regarde droit dans les yeux. Le noir de son pelage contraste avec les tons beiges des champs en arrière plan, je lui parle pour essayer de le calmer, je ne suis pas tranquille, je sors lentement de ma tente et me lève, les chevaux ne m’inspirent pas vraiment confiance.
Après quelques minutes (qui semblent être des heures) de négociation avec l’étalon, je sens qu’il est sur le point de céder. À ma grande satisfaction, il décide de passer son chemin avec tout le groupe. Me voilà soulagé. Plus tard dans la nuit, je les entendrai passer juste à côté de moi.
23 septembre
La nuit à été pluvieuse, la toile de ma tente ne l’a pas supporté, mes affaires sont trempées. Il n’y a rien de pire que de se lever avec ses fringues humides. Dehors, il fait frais. Qu’une solution pour me réchauffer : mes derniers sachets de café soluble. Je ne tarde pas à plier bagage, il est temps de donner les premiers coups de pédales de la journée.
Les jambes sont raides et froides, il me faut plusieurs kilomètres avant de prendre le rythme. De part et d’autres de la piste se succèdent des champs arides et de rares fermes. La carte postale change du tout au tout, les cèdres rouges de l’Ouest ont cédé leur place à une végétation bien moins luxuriante.
Plus les jours passent, plus mes jambes s’habituent à la tâche qu’est la leur, pédaler. Pour le moment mes pneus montés en tubeless résistent aux pistes canadiennes. Je n’ai pas eu à les regonfler depuis que j’ai débarqué à Vancouver il y a presque 15 jours de cela. D’ailleurs, jusqu’ici, je n’ai eu aucun soucis mécanique, ni crevaison ni chaine cassée. Je touche du bois, comme on dit.
De temps à autre, au milieu de la sécheresse, je remarque une parcelle d’herbe grasse, irriguée avec soin. Les ours en raffolent. À la fin de la journée, j’en comptabilise cinq ! Je surnomme naturellement cette route, « la vallée aux ours ». Je traverse un petit village de natifs proche du lac Douglas où je fais un stop à la supérette locale pour refaire mon stock de barres chocolatées. Quand le moral n’est pas au beau fixe, elles sont idéales pour le remonter.
24 septembre
Me voilà de retour sur le bitume. Je préfère la piste incertaine et difficile qui conduit vers l’inconnu à n’importe quelle chaussée pavée. Les roulements des moteurs de la route 97 sont là. Ça ne m’avait pas manqué. Les cheminées fument, l’automne se fait sentir.
Il est l’heure de manger. Je m’arrête au café, derrière moi, quatre hommes d’un certain âge sont en train de déjeuner. En buvant mon café, je laisse traîner l’oreille. L’un d’eux raconte que tôt le matin il s’est trouvé nez à nez avec un ours noir en sortant son chien dans le quartier. Ce sont des choses qui arrivent ici mais qui ne cesseront jamais de me provoquer une émotion particulière.
Mon déjeuner terminé, je me lève et trace ma route, Je ne connaîtrai jamais la fin de l’histoire…
En regardant la carte je constate qu’une piste cyclable se trouve à proximité du lac Kalamalka et le longe sur sa totalité. Il paraît que ses eaux aux teintes émeraudes sont magnifiques. En plus, j’ai de la chance, il fait beau. Je passerai la nuit au bord du lac. Il me reste quelques nouilles chinoises.
Une petite colonie de Colins de Californie ont élu domicile dans une haie à quelques mètres de ma tente, ils sont curieux mais farouches. Pour les photographier, je m’assois dans la tente, ferme le zip d’entrée et laisse une ouverture juste assez grande pour y glisser mon téléobjectif. Ensuite, j’attends que la petite colonie, en confiance, sorte de la haie pour chercher de la nourriture dans l’herbe rase, sans soupçonner pas que je les observe et je fais des images. Demain, je rallierai la destination finale de mon voyage, non sans nostalgie, déjà.
25 septembre
J’arrive à Kelowna, une ville splendide bordée par l’immense lac Okanagan. Les saumons Kokanee remontent ce cours d’eau, ils ressemblent drôlement à leurs cousins Sockeye, seul la taille les différencie de ces derniers. C’est ma dernière journée avant de prendre un vol pour le Yukon, province historique de la ruée vers l’or.
Je me balade avec mon vélo le long de la rivière, la fin de journée approche et plus je progresse sur le sentier de terre moins je vois de monde. Je traverse un petit bois de cèdres rouges de l’Ouest puis un pont suspendu, je laisse mon gravel contre un arbre et continue à pied. Je me pose et observe. La nuit ne va pas tarder à tomber, la lumière est douce. Juste en face, sur la rive opposée à flanc de falaise, un ours avance lentement, je profite de l’instant. Il m’a vu mais ma présence ne semble pas l’inquiéter. Je prends quelques photos, puis laisse l’appareil de coté pour m’imprégner pleinement du moment. Il disparaît dans la forêt. C’est sur cette dernière image que mon aventure de 800 kilomètres à travers l’Ouest canadien s’achève, des souvenirs plein la tête.
Conseils pratiques pour un trip à vélo en Colombie-Britannique
Équipé de mon vélo gravel, j’y ai monté des pneus tubeless section 33 avec un léger crantage pour avoir du confort sur la piste mais aussi pas mal de roulabilité sur le bitume, et avec ça, une paire de pédales semi automatique.
Pour gagner un peu en aérodynamisme et garder ce style profilé, mon choix s’est porté sur une sacoche de guidon, deux sacoches de fourches facilement amovibles, une sacoche de cadre et une sacoche de selle.
Dans les sacoches
Je vous recommande Boutique Sauvage et Akammak pour trouver la majeur partie de votre équipement.
- réchaud à gaz nomade
- oreiller gonflable compact
- tente de camping 3 saison
- serviette microfibre
- panneau solaire nomade
- Multi-tool
- Antivol
- Pompe à main
- Haut technique
- Collant technique
- Cuissart court
- Bonnet
- Cache-cou
- Veste de pluie
- Doudoune légère
Malgré tout, voyagez le plus léger possible et ne prenez que le matériel que vous êtes sûrs d’utiliser. Chaque gramme économisé sera appréciable lorsque vous grimperez des cols.
Enfin, renseignez-vous sur le danger que représente la faune sauvage de l’Ouest canadien, et notamment les ours et partez équipés au moins d’un spray.
INSTAGRAM — Rejoignez la plus grande communauté de nouveaux aventuriers